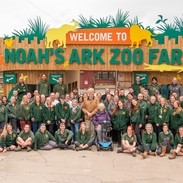- Au restaurant ou à l’hôtel
L’aristocrate était d’abord et avant tout à la recherche d’un certain raffinement à la française. En 1889, le tout nouveau Savoy, construit par Richard D’Oyly Carte, le propriétaire du Savoy Theatre voisin et dirigé par César Ritz avec Auguste Escoffier en cuisine, impose la haute cuisine moderne tandis que le Café Royal sur Regent street (1865), réputé pour ses champagnes et ses dîners tardifs après les représentations, offre un décor Belle Époque digne des boulevards parisiens. Plus anglais, Simpson’s-in-the-Strand (inauguré en 1828 mais actuellement fermé pour rénovation) perpétue la tradition du Sunday roast, et Rules sur Covent Garden (1798), le plus ancien restaurant de la capitale, demeure le sanctuaire du gibier de saison. Avec l’ouverture du Ritz London en 1906 et du Carlton Hotel sur Haymarket en 1899 (bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale puis démoli), la mode des grands hôtels-restaurants s’impose : déjeuner sous une coupole de cristal ou prendre le thé “au Palm Court” fait alors partie de l’art de vivre aristocratique. Installé au cœur de l’ancienne résidence du Duc de Westminster, le Grosvernor House Hotel est inauguré en 1929 dans le quartier de Mayfair.
- Côté shopping
Au début du XXᵉ siècle, faire ses emplettes relevait pour l’aristocratie anglaise d’un art de vivre codifié, une chorégraphie quotidienne inscrite dans un territoire bien précis. Piccadilly, Bond Street et Knightsbridge formaient un triangle d’or où l’on dépensait sans compter. Pour les provisions de luxe et les paniers (hampers) pique-nique, Fortnum & Mason (1707) était l’adresse incontournable, tandis que Harrods (reconstruit entre 1880 et 1912) s’impose comme un temple de la consommation impériale, capable de fournir aussi bien du caviar de la Caspienne que des accessoires de chasse en or massif.
A l’époque, le vestiaire masculin s’élaborait sur mesure. Les dandys font tailler leurs vestes chez Henry Poole & Co. (1806) ou Huntsman (1849) sur Savile Row, avant de choisir un gilet de flanelle chez J. C. Cording & Co. (1905).
Mais c’est dans le quadrilatère de St James’s que s’exprimait le raffinement masculin de l’époque. Chez Lock & Co. Hatters (1676), l’aristocratie choisissait ses bicornes, top hats ou trilbys dans ce qui est sans doute le plus ancien modiste du monde encore en activité. Fréquentée par Nelson, Wellington et Churchill, la maison propose des couvre-chefs taillés à la main et ajustés au millimètre, dans un décor de boiseries sombres et de boîtes à chapeaux numérotées. À quelques pas, Swaine Adeney Brigg (1750) forgeait des parapluies à armature de baleine, des cannes et mallettes en cuir au prestige incontesté. Les fumeurs passaient chez James J. Fox (1787) pour recharger leur cave à cigares havanais, puis descendaient jusqu’à Berry Bros. & Rudd (1698), caviste attitré de la Couronne, dont les caves voûtées abritaient clarets de Bordeaux et portos millésimés.
Perpendiculaire, Jermyn Street, véritable colonne vertébrale de l’élégance londonienne, les dandys dénichaient des chemises à poignets mousquetaires chez Turnbull & Asser (1885), des cravates soyeuses chez Hawes & Curtis (1913), des souliers patinés chez Crockett & Jones (1879). Enfin, chez Floris (1730), on peaufinait son allure avec des eaux de toilette emblématiques, comme le « No. 89 », des baumes à raser, des savonnettes monogrammées et autres articles de grooming pensés pour prolonger le vernis du gentleman jusque dans les moindres détails.
Lorsque le ciel londonien virait au gris, on se repliait sous les verrières des galeries commerçantes. Burlington Arcade (1819), première galerie couverte de la capitale, reliait Piccadilly à Cork Street, gardée par ses Beadles en redingote rayée. On y croisait bottiers, horlogers, gantiers et joailliers dans une atmosphère feutrée où le cuir ciré rivalisait avec le chatoiement des vitrines. Piccadilly Arcade (1909), plus intime, séduisait pour ses montres suisses, ses boutons de manchette en émail et ses tailleurs confidentiels. Enfin, Princes Arcade, discrètement nichée entre Jermyn Street et Piccadilly, complétait ce triptyque du shopping d’élite, avec ses boutiques de niche, ses accessoires raffinés et son ambiance feutrée, à mi-chemin entre club privé et salon de thé.
Aujourd’hui encore, la plupart de ces enseignes perdurent, intactes dans leur savoir-faire et leur élégance. Il suffit de pousser la porte de Floris, de commander un Panama chez Lock & Co., ou de traverser Piccadilly Arcade pour se prendre, l’espace d’un instant, pour un lord de l’époque édouardienne.
- Les Clubs
A l’époque de Downton Abbey, les clubs étaient l’ossature du pouvoir mondain. Dans la petite enclave de St James’s, White’s (1693) restait la citadelle des tories, Brooks’s (1764) celle des whigs, tandis que The Carlton Club (1832) drapait le conservatisme dans des fauteuils de cuir vert. Les diplomates préféraient The Travellers’ Club, les intellectuels l’Athenaeum et les dramaturges le Garrick. Le Reform Club (1836), fondé sur les principes du libéralisme progressiste issus du Reform Act de 1832, devint rapidement le bastion des réformateurs radicaux et des penseurs éclairés. Installé dans un somptueux bâtiment de style Renaissance italienne, il ouvrit ses portes à une élite cultivée et cosmopolite, accueillant notamment l’écrivain William Makepeace Thackeray ou Jules Verne, qui y fit séjourner Phileas Fogg dans Le Tour du monde en 80 jours. Ce fut également l’un des premiers clubs à rompre avec les traditions masculines en admettant des femmes membres dès 1981, marquant une rupture discrète mais significative avec l’exclusivisme du XIXe siècle.
Aujourd’hui, les clubs privés perdurent. Certains ont pris une tournure plus hédoniste et créative, à l’image de la chaîne Soho House, fondée en 1995 à Londres. Pensés pour une clientèle jeune, cosmopolite et active dans les industries culturelles, ces clubs misent sur le design, le networking et une ambiance décontractée mais sélective. Plus inclusifs que leurs ancêtres victoriens, ils privilégient la diversité des profils aux lignées aristocratiques. Soho House incarne la métamorphose d’un modèle ancien en un art de vivre mondain, globalisé et connecté.
- Divertissements
Au début du XXᵉ siècle, les théâtres et salles de concert occupaient une place centrale dans la vie mondaine de l’aristocratie anglaise. Ils constituaient des lieux de sociabilité essentiels, où l’on venait autant pour voir que pour être vu, entretenir des relations stratégiques, faire des alliances discrètes… tout en cultivant une apparente passion pour les arts. Le Royal Opera House, à Covent Garden, était l’épicentre de cette vie culturelle raffinée. Temple majestueux de la musique classique et de l’opéra, il attirait l’élite lors des grandes soirées de gala, où les dorures, les lustres étincelants et les loges privées formaient l’écrin parfait à une représentation du Don Giovanni ou de La Traviata. Posséder sa propre loge, souvent transmise de génération en génération, était un véritable marqueur social, et s’y rendre obéissait à un cérémonial précis : robes longues brodées de perles, diadèmes scintillants, gants blancs et smokings de rigueur.
Autour du Royal Opera House gravitaient d’autres théâtres prestigieux ou plus intimistes comme le Haymarket Theatre, le Palace Theatre ou encore le St James’s Theatre. Chacun proposait une programmation en phase avec les goûts d’une société qui appréciait autant les pièces de Shakespeare que les comédies de mœurs ou les drames contemporains portés par les stars montantes de la scène londonienne. Ces lieux étaient des refuges de raffinement où les élites venaient affirmer leur appartenance à une culture partagée, souvent empreinte d’un nationalisme feutré.
Le Royal Albert Hall complétait ce paysage culturel avec une touche plus grandiose et patriotique. Ses concerts, notamment les Proms fondés en 1895, attiraient une foule mélangée, mais les soirées les plus prestigieuses restaient le domaine réservé des grandes familles. Dans ce cadre monumental, où résonnaient les échos de Rule, Britannia! ou de Land of Hope and Glory, se mêlaient ferveur musicale et esprit d’Empire.
Planifiées avec soin dans les carnets mondains, ces sorties ne relevaient pas du simple divertissement : elles participaient à la mise en scène d’un rang social, au maintien d’un réseau, et à l’affirmation d’un certain idéal du bon goût britannique. Ce rituel théâtral, à la fois esthétique et stratégique, s’inscrivait pleinement dans l’univers de l’aristocratie édouardienne, un univers que la série Downton Abbey illustre avec une précision et une élégance remarquables, notamment dans le dernier opus, Downton Abbey, Le Grand Final au cinéma le 10 septembre 2025.